Jones a écrit trois brouillons distincts de Time Is Tight, dont le premier était un récit chronologique aride de 900 pages sur sa vie, en commençant par ses ancêtres esclaves. Avec l’aide de ses éditeurs, il a opté pour un récit non linéaire, impressionniste, structuré en une série de vignettes. La prose de Jones est richement évocatrice, surtout lorsqu’il décrit son éducation musicale à Memphis. « Je pensais à la musique, toujours », écrit-il. « Rythmes. Des symphonies. » Lorsque Jones a reçu sa première clarinette, à l’âge de neuf ans, il se souvient de « l’odeur humide de l’étui, du bois noir, du beau feutre vert foncé qui caressait chaque pièce. »
Time Is Tight est aussi un portrait implacablement honnête du mandat souvent turbulent de Jones chez Stax Records, qui fait beaucoup pour dissiper, ou du moins compliquer, le mythe de Stax comme utopie interculturelle harmonieuse. « Mon groupe est devenu le « visage » de l’harmonie raciale, au sens propre comme au figuré », écrit Jones. « Cela a mis une pression démesurée sur moi pour rassurer les circonscriptions que c’était effectivement le cas et confirmer que la conception est exacte. »
Populaire sur Rolling Stone
Jones n’a pas beaucoup discuté de son rendu quelque peu controversé de l’apogée de Stax Records avec beaucoup d’hommes et de femmes qui étaient là dans les années 60. « Tant de joueurs sont partis », dit-il. A-t-il partagé le livre avec Al Bell, l’ancien chef de Stax Records Al Bell qui n’est pas toujours dépeint sous un jour positif dans le livre de Jones ?
« Il l’a lu », dit Jones, « mais nous n’avons pas parlé. »
La semaine dernière, Jones s’est assis pour une conversation dans le bureau de son éditeur à Manhattan pour discuter de son livre, des mythes qui ont longtemps présidé à Stax Records, de la production de Willie Nelson et d’autres aspects de sa carrière légendaire.
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire un livre ?
Au début, j’écrivais juste pour m’entraîner à écrire des chansons. J’avais un livre sur l’écriture de chansons qui disait : « Écris sur ce que tu connais », et cela a fini par être ma vie. J’ai montré quelques essais à ma femme, et elle a dit, « Tu devrais en faire un livre. » J’ai donc commencé à chercher ma voix, que je n’ai pas trouvée pendant des années. J’ai commencé à lire d’autres mémoires, et à lire en général : Alice Walker, Faulkner, Tolstoï, des livres scientifiques, The Golden Ratio de Mario Livio. Ce n’est que juste avant la sortie de cette dernière version que j’ai trouvé la voix de Booker T. Jones.
Les sections de votre livre sur votre formation musicale formelle approfondie à l’université d’Indiana étaient vraiment éclairantes. Trop souvent, la musique soul est dépeinte exclusivement comme une expression personnelle brute, par opposition à une forme structurée et très pratiquée.
A Stax, il y avait une infusion de la connaissance de la composition à travers moi à mes partenaires. Les chansons ont reçu une certaine structure, je pense, inconsciemment, à travers moi, à travers les connaissances que j’ai acquises en apprenant et en étudiant la musique du passé : La musique européenne, la musique africaine, la musique orientale, toutes ces choses que j’ai apprises à Indiana et que je n’aurais pas pu obtenir en l’air. Stax était un mélange de cette expression, comme vous l’avez dit, et d’un peu de Bach structurel et d’un peu de Mozart.
L’un des grands paradoxes du livre semble être le peu de temps que vous passiez réellement à Memphis pendant la période du début des années 60 où, grâce à votre travail avec Booker T. and the MG’s, vous êtes devenu à jamais associé à la ville.
L’un des sous-textes de ce livre est à quel point le temps est insaisissable comme ça. Quelques années seulement peuvent signifier beaucoup dans un endroit, et pas tellement dans un autre. Je suis né à Memphis, j’étais donc dans le jardin, et j’ai côtoyé toutes ces figures, ces influences et ces musiciens, les grandes traditions du blues, du jazz et de la country. C’était ancré en moi, chez mes parents et dans tout le reste. Je respirais cela. Cela fait une grande différence.
Parfois le temps s’étire. Le temps qu’il a fallu pour enregistrer « Try a Little Tenderness », c’est un temps plus important que… Ne voyons pas toujours le temps comme un élément linéaire. Il peut avoir ses différentes qualités. Quelqu’un qui émet comme Otis, quand vous ressentez ces émotions, que vous avez un rythme, que vous bougez et que vous êtes sur un bateau ensemble, c’est complètement différent du temps réel. C’est l’une des choses que j’ai apprises en écrivant sur ces expériences. Je suis heureux que le livre s’appelle Time Is Tight.

Peut-être que la section la plus émouvante de tout le livre est celle où vous décrivez le fait d’entrer dans les studios Stax une dernière fois avant de déménager en Californie pour effacer l’enregistrement de votre chanson « Ole Man Trouble » après que le responsable du label, Al Bell, vous ait dit qu’il n’était pas à l’aise pour publier la chanson.
J’étais sur le point de me lancer dans ma quête spirituelle : méditer, comprendre qui j’étais, ce que j’étais. Qu’est-ce qui se passe ? Quelles sont mes limites ? J’ai écrit la chanson « Ole Man Trouble » . C’était, « Je ne vais plus travailler à la ferme de Maggie », en gros. Al Bell dirigeait une entreprise qu’il voulait transformer en géant. C’était son truc, et c’est bien. Je le voulais aussi. J’ai enregistré cette chanson.
J’avais dépensé beaucoup de leur argent pour cette chanson : cornes, cordes, temps de session. Al Jackson est resté debout tard avec moi pour l’enregistrer. C’était un magnifique chef-d’oeuvre. Et je chantais. Ils ne voulaient pas que je chante. Ils avaient un grenier à blé à Stax avec moi, Cropper, Dunn et Jackson : on était plutôt isolés en tant que groupe maison. Je me suis dit : « Peut-être que quelque chose de différent pourrait arriver. » Mais lors de cette rencontre avec Al, j’ai compris que ça n’arriverait pas. Quand j’ai quitté sa maison, j’ai compris que c’était fini. J’avais déjà rencontré Leon Russell en Californie. J’avais vu Hollywood. J’avais rencontré Billy Preston, et Billy m’a dit : « Combien d’argent tu gagnes à Memphis ? J’ai répondu : « Je gagne 375 dollars par semaine. » Il a dit : « Je gagne 50 000 $ par an. » Ce genre de choses. C’était la Californie. J’avais respiré un peu d’air. Alors je suis parti. On avait enregistré « Time Is Tight », et c’était le moment. C’était le moment. Le temps de rencontrer mon plus grand moi.

Dans le livre, vous vous donnez beaucoup de mal pour compliquer certains des mythes qui ont été si fermement installés pendant si longtemps sur l’utopie multiraciale de Stax Records.
Des mythes qui font de l’argent.
Lorsqu’on vous a demandé ce que c’était que de travailler au sein de Booker T. and the MG’s, un groupe multiracial que le reste du monde croyait parfaitement harmonieux, vous avez récemment déclaré : « Il y avait plusieurs niveaux de retenue qui devaient être mis en place. » Qu’entendiez-vous par là ?
D’incessantes hiérarchisations subconscientes sur ce qu’est l’objectif, ce qu’est le but. On a fait ça pendant des années. C’est ce qui arrive souvent. Nous parlons ouvertement maintenant, mais nous ne le faisions pas à l’époque. On travaillait juste dans un but supérieur, qui était de faire de la musique. Et la musique a probablement finalement fait plus que si nous l’avions décomposée et discuté de la politique ou de la race.
Même si ces arguments étaient très présents.
Exactement. Mais nous étions sur le point de faire « Green Onions ». C’était donc ça : « Oignons verts », ou se battre sur la race ? Maintenant que le temps a passé, c’est bon. C’est OK.
Vous avez écrit que l’idée qu’il n’y avait pas de problèmes dans le groupe a commencé à ressembler à un placage.
C’est un peu un phénomène humain. Quand les gens suggèrent que vous êtes parfait, vous commencez à ne plus l’être. Le fait même qu’ils disent ça : « Booker T. et les MG sont l’image de la coopération raciale », et puis presque plus ça a commencé à se produire, plus ça a commencé à devenir faux. Nous sommes tombés dans ce piège. C’est presque comme si la pression elle-même qu’elle crée la faisait s’effondrer.
Cela a dû être une chose tellement compliquée, difficile à naviguer en tant que jeune personne, vivant avec ce mythe qu' »à l’intérieur des murs du studio de Stax, on ne voyait pas la race. »
Et c’était beau parce qu’on devait faire toutes les règles là-dedans. C’est le plus grand mérite que je donne à Jim Stewart. Quelle que soit son opinion, il nous a donné un studio libre, sans aucune dictée de l’extérieur. C’était un cadeau au monde, et à nous.
Avez-vous déjà parlé publiquement de certains de vos sentiments les plus compliqués, les plus troublés, concernant Stax et Booker T. and the MG’s avant d’écrire ce livre ?
J’ai trouvé ça difficile à dire, difficile à développer. Quand j’ai eu le temps de m’asseoir et d’assembler les mots, il était plus facile de rendre mes pensées précises et de leur donner de la clarté.
Il y a un moment dans le livre où vous parlez de ce que vous appelez « la première fissure dans un groupe interracial qui semblait si soudé vu de l’extérieur. » Al Jackson, le batteur d’origine du groupe, s’était mis en colère contre le guitariste Steve Cropper.
C’est à ce moment-là qu’Al Jackson m’a dit : « Je vais mettre ce fils de pute KO » Cropper. Immédiatement, la responsabilité m’incombait. Al me l’a dit, alors il est devenu de mon devoir de ne pas le laisser faire. La dynamique a changé, et nous y voilà. Et ce n’était pas un truc racial ; il aurait dit ça si Cropper était noir. Mais c’était quand même une fêlure.
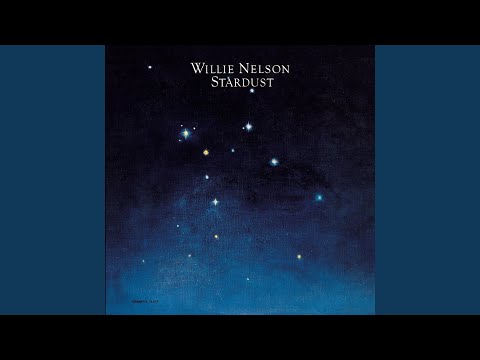
Avez-vous des souvenirs marquants de la production du Stardust de Willie Nelson dans les années 70 ?
J’en ai. Je me souviens de la première fois où j’ai vu Willie courir sur la plage de Malibu. J’ai pensé, « Ce gars ressemble à Willie Nelson. » Bien sûr, c’était Willie Nelson. Plus tard, Willie a décrit comment il aimait Bob Wills et les Texas Playboys. Il a commencé à parler des chansons qu’il avait chantées quand il était petit et qu’il jouait dans les clubs après avoir vendu des bibles. C’étaient les mêmes chansons que j’avais jouées à Memphis avec Willie Mitchell et son groupe. C’est alors que le déclic s’est produit : « Faisons ces chansons. » Et principalement, c’était « Stardust ». La chanson de Hoagy Carmichael. Quand j’ai joué la mélodie pour la première fois et que j’ai réalisé que Hoagy Carmichael était allé dans l’Indiana, je me suis dit : « C’est ce que je veux faire. C’est là que je veux aller à l’école. »
Avez-vous encore des projets musicaux que vous voulez accomplir ? De nouvelles choses que vous voulez essayer?
J’ai pris quelques leçons de synthétiseur, donc j’ai encore des chansons au synthétiseur que je veux faire. Je travaille un peu avec Malcolm Cecil, quand il avait le vieux synthétiseur de Stevie Wonder qu’il utilisait, TONTO. Aussi, j’avais l’habitude de jouer des disques pour les enfants quand j’étais au lycée. J’organisais des fêtes chez moi. Il y a un peu de DJ en moi.